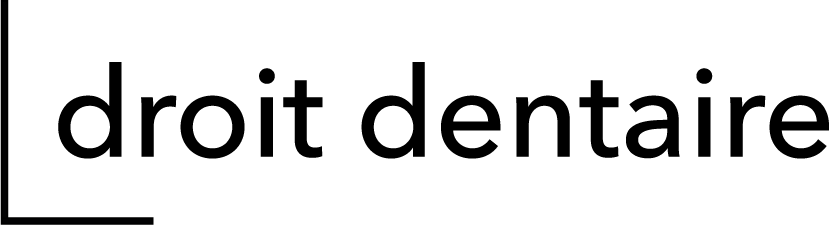La reconnaissance de la responsabilité médicale du professionnel de santé repose, entre autre, sur l’existence d’une faute (qu’elle soit technique ou non technique). Mais cette faute doit être prouvée : la simple évocation d’une faute par l’expert, sans démonstration solide de sa part, n’est pas suffisante pour engager la responsabilité d’un praticien.
Tribunal judiciaire de Nantes, 15 janvier 2026, RG nº 23/05636
Les faits
En juin 2018, un patient consulte un chirurgien-dentiste pour la réfection d’une couronne sur la dent 27, pourtant posée 3 ans auparavant. Un traitement endodontique est réalisé et une couronne provisoire est mise en place, fin 2018. Alors que le praticien souhaite poser la couronne définitive, le patient s’y oppose, un temps. Finalement, celle-ci est posée fin 2019.
Quelques mois plus tard, le patient se plaint d’un problème de teinte et de douleurs : il consulte d’autres chirurgiens-dentistes et sollicite une expertise amiable auprès de son assureur. Cette expertise, non contradictoire, conclu que la couronne est « mal adaptée dans sa forme et sa fonction ».
Le patient s’engage ensuite dans une action en justice, aux fins d’obtenir près de 19 500 euros d’indemnisation au titre de divers préjudices (notamment, il demande 3000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent pour cette dent du secteur postérieur)
Une expertise judiciaire est diligentée en référé. L’expert conclut que les soins prodigués étaient justifiés et adaptés au traitement de l’état du patient et que le traitement endodontique a été correctement réalisé. En revanche, l’expert se lance dans un long développement au sujet de la conformité de la couronne définitive :
« La seule faute qui peut être imputée au Docteur [V] est la réalisation d’une couronne prothétique surdimensionnée. Ce défaut est inhérent au type de matériau utilisé qui nécessite une épaisseur supérieure à celle d’une couronne métallique. L’erreur est de ne pas avoir suffisamment réduit la chape prothétique, d’autant plus qu’un inlay core était prévu, et de ne pas avoir été critique sur ce point avant le scellement . Cette situation est courante dans la pratique dentaire, mais dans le cas présent, les douleurs alléguées par le patient sont susceptibles d’être une conséquence de ce défaut de conception ». […]
« Les désagréments décrits par M. [L] relèvent probablement d’un tassement alimentaire entre les dents 26 et 27. La morphologie de la couronne de la dent 27 « bloque » les aliments durs entre ces 2 dents et compriment le septum osseux inter-dentaire qui devient douloureux et se détruit »
« Aucune infection dentaire n’apparait cliniquement ou radiologiquement. Des douleurs sont déclarées en rapport avec la mastication. Ces douleurs sont susceptibles d’être causées par une morphologie inappropriée de la couronne prothétique. Ces douleurs ne sont pas déclarées à l’état antérieur et peuvent être considérées comme une conséquence des soins. »
Au cours des dires, la partie défenderesse réaffirme l’absence de sur-dimensionnement de la dent. L’expert maintien son diagnostic de sur-dimensionnement mais précise (« curieusement » nous dit la décision de justice) que « cette morphologie n’est pas le point principal du litige » puis que « sans que ce point soit essentiel à la résolution du litige » « il ne peut être soutenu que la dent 27 est en conformité morphologique avec sa voisine (dent 26) et symétrique (dent 17) ».
La décision
Le tribunal ne se satisfait pas des conclusions de l’expert. Il considère que celui-ci raisonne par « hypothèses successives » et procède à des « suppositions », sans tirer de celles-ci des conclusions sur le respect ou non des règles de l’art par le chirurgien-dentiste incriminé. Le tribunal retient également qu’aucune démonstration scientifique n’est proposée par l’expert aux fins de retenir l’existence d’une faute médicale, condition sine qua non de l’engagement de la responsabilité médicale du professionnel de santé.
Le tribunal retient donc l’existence d’un aléa thérapeutique : il déboute le patient de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépends.
Il convient de noter que le patient, depuis l’expertise judiciaire, a fait extraire sa dent 27.
Discussion
Le régime de responsabilité médicale pour faute a été consacré par la loi du 4 mars 2002 (cf. l’article L. 1142-1, I du Code de la santé publique). Suivant l’esprit de la loi, en l’absence de faute de la part du prestataire de santé (professionnel, établissement ou organisme de santé) dans la réalisation d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins aux conséquences dommageables, sa responsabilité civile ne peut être retenue.
Dès lors, juridiquement parlant, la complication iatrogène survenue au décours de la prise en charge médicale est qualifiée « d’aléa thérapeutique« . En matière de responsabilité médicale du chirurgien-dentiste, cette notion d’aléa thérapeutique est toutefois rarement rencontrée, puisque dans 3 affaires sur 4, la responsabilité de ce dernier est engagée devant les juridictions civiles. Ce chiffre, présenté par le premier assureur RCP de la profession (la MACSF), conduit ce dernier à évoquer le glissement d’un régime de responsabilité à un régime de réparation : les patients et leurs conseils en viennent à évoquer systématiquement la faute du professionnel et quand aucune faute technique ne peut être démontrée, alors est invoquée le défaut d’information, faute non technique difficilement contestable pour le professionnel de santé du fait de l’inversion de la preuve.
Côté expert, il semble exister une culture de la faute qui peut conduire, à excès, à vouloir trouver une faille dans un dossier. Lorsqu’elle n’est pas flagrante, la faute est suspectée, expliquée à travers un raisonnement fondé sur la supposition et dont le point de départ est la conséquence dommageable. La présente décision de justice illustre parfaitement cette problématique de raisonnement médico-légal.
Quant au choix des mots, il s’agit d’un écueil majeur de cette affaire. On passe ici de la « faute » à « l’erreur », puis à des qualifications relevant davantage du défaut de produit de santé que de geste technique : « défaut de conception », matériau présentant un « défaut inhérent ». Enfin, l’expert évoque une « situation courante » en pratique dentaire pour qualifier la complication alléguée par le patient !
Cette décision de première instance illustre avec acuité l’importance, pour l’expert, du choix des mots et de la cohérence du raisonnement médico-légal. À défaut, ses conclusions peuvent être fragilisées, voire écartées par le juge.
Une telle prudence semble d’autant plus importante que les écueils du patient ne sont pas anodins et peuvent laisser songeurs : pourquoi évoquer un préjudice esthétique de près de 3000 euros pour une deuxième molaire maxillaire ? Pourquoi s’être lancé dans une procédure judiciaire alors qu’une réfection prothétique suffisait amplement ?
Reste à savoir si ce patient, débouté en première instance, choisira ou non d’interjeter appel. Dans un contexte où une nouvelle réunion d’expertise ne permettra pas d’évaluer un défaut de conception prothétique, la dent litigieuse ayant été extraite.